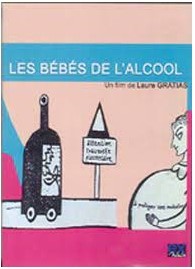Contribution parue dans l’ouvrage « le code pénal de 1994, 30 ans d’application et d’évolution » – Editeur LexisNexis – date de parution: 28 mai 2025 – EAN: 9782711042111
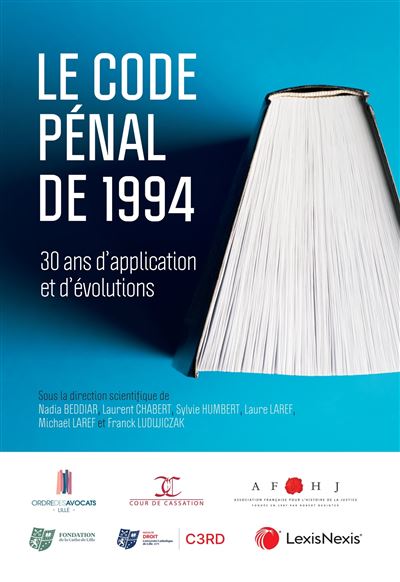

Je me réveillerai, et les lois et les mœurs auront changé (Arthur Rimbaud)
On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré (Albert Einstein)
Les biens que l’on s’approprie sont aussi des milieux où séjourne l’espèce humaine (Sarah Vanuxem[1])
Interroger les perspectives du code pénal dans 30 ans renvoie à un temps paradoxalement aussi proche qu’indéchiffrable tant la somme annuelle de transformations du monde se densifie chaque année.
C’est comme si une année de maintenant en valait quatre d’il y a trente ans, d’où ce sentiment d’accélération.
Difficile dans ces circonstances d’anticiper un besoin, une attente sociale quant au contenu et à l’évolution du code pénal qui constitue un corpus central et très signifiant de notre contrat social.
L’exercice autorise donc d’imaginer comment notre société aura résolu des questionnements qui lui paraissent aujourd’hui à la fois centraux et insolubles.
Le premier sujet qui émerge réside dans le développement de l’IA et des machines autonomes et la généralisation de leurs usages.
Les perspectives d’une justice robotisée ou de machines responsables inspirent autant l’imagination que les craintes des juristes qui se sont rapidement questionnés sur la pertinence à créer une personnalité juridique adaptée à des machines autonomes, notamment pour répondre au besoin de maitriser les risques d’usage.
Le Parlement européen dans une résolution du 16 février 2017[2] relative aux règles du droit civil de la robotique proposait de créer à terme une personnalité juridique spécifique aux robots.
Mais depuis lors, la majorité de la doctrine s’est accordée sur les dangers et le non sens (autre que narcissique ?) d’une telle évolution[3].
Ce débat a eu en tous cas le mérite de remettre en avant l’une des fonctions de la personnalité juridique qui est aussi de protéger les personnes qui en sont dotées[4].
L’autre grand questionnement de notre société actuelle porte sur sa capacité à maitriser et endiguer d’ici 2050, dans trente ans donc, les dérèglements climatique et environnementaux dont elle est responsable.
Projetons nous en 2054 et imaginons que l’humanité soit parvenue à cet objectif.
Compte tenu des changements profonds que cela suppose, quels en seraient les impacts sur notre code pénal ?
Les juristes le savent, le droit est le reflet de la société humaine dont il est issu et son étude permet d’en apprendre beaucoup sur celle-ci[5].
Sa pratique procure aussi une occasion d’observer comment le changement opère au travers d’un dialogue constant entre la société et le droit qui la régule.
Ce dialogue met en mouvement l’état de droit dont la structure assure la pérennité de notre contrat social et de la paix civile tout en intégrant le changement en continu, notamment au travers de la Justice.
A l’appui de cette double expérience d’étude et d’action, il est donc possible d’imaginer à quoi ressemblerait le droit en général qui régulerait une société humaine parvenue à tenir ses grands rendez-vous climatiques fixés à dans 30 ans, que ce soit pour la neutralité carbone[6], la restauration de la biodiversité[7], des milieux écosystémiques et des océans[8].
Le code pénal est composé de sept Livres dont quatre concernent les grands domaines que la loi pénale protège, savoir les personnes, les biens, la nation et nous avions failli l’oublier, les lois et coutumes de la guerre.
L’un des signes qui pourraient signifier pour l’observateur de 2024 la réussite de ces grands rendez-vous climatiques serait de voir introduit dans le code pénal d’ici 30 ans un Livre entier dédié aux crimes et délits contre la Nature.
Ainsi posée, cette prospective interpelle rétroactivement le juriste du présent qui mesure la distorsion entre la propension répressive en général des dispositions touchant à l’environnement et leur absence totale dans le code pénal actuel.
I. Le droit de l’environnement, un droit répressif mais absent du code pénal
C’est un constat certainement signifiant : les quelque 2000 infractions au droit de l’environnement sont prévues et réprimées dans de nombreux codes (de l’environnement bien sur, mais aussi rural et de la pêche maritime, forestier, minier, de l’urbanisme, de la santé publique, de l’énergie etc…)
Aucune de ces infractions, même pas l’écocide codifié aux articles L. 231-1 et suivants du code de l’environnement, n’est actuellement prévue et réprimée par le code pénal.
Comme signe d’évolution, il est d’ailleurs intéressant d’observer que l’écocide vient d’être intégré au nouveau code pénal belge publié au Moniteur le 8 avril 2024[9].
En France, le législateur a créé voilà presque 25 ans le code de l‘environnement[10] dont les dispositions générales, notamment son article L. 110-1 qui énonce le principe de nature comme patrimoine commun de la nation, se sont fortement étoffées.
Il a également doté notre bloc constitutionnel d’une Charte de l’environnement dont le préambule énonce plusieurs principes essentiels dont il découle selon le Conseil Constitutionnel que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle[11].
Mais 25 ans plus tard, le droit de l’environnement demeure un droit éclaté, « ventilé ».
Le code de l’environnement demeure truffé de renvois et sa lecture nécessite toujours d’avoir à disposition une quinzaine d’autres codes, du code de l’urbanisme en passant par le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, voire le code des douanes et plus récemment le code de l’énergie[12].
Le conseil général de l’inspection générale de la Justice (devenu IGEDD) et l’inspection générale de la Justice préconisaient dès 2019 dans un rapport commun de faire rentrer dans le code pénal les incriminations environnementales les plus graves issues de ces différents codes[13].
La démarche de ces deux inspections qui a abouti à l’élaboration de 21 recommandations était déjà guidée par le constat d’une difficulté certaine à parvenir à mobiliser de manière coordonnée les services administratifs en charge de la police de l’environnement avec les magistrats de l’ordre administratif et judiciaire et par une réparation jugée non satisfaisante du préjudice écologique sur le plan civil[14].
Mais outre le fait que cette proposition est essentiellement guidée par une logique de recodification à droit constant et demeure très éloignée de la création d’un Livre entier du code pénal dédié aux infractions contre la Nature, elle ne résout pas la problématique de l’éclatement des quelques autres 2000 infractions environnementales réparties dans le code rural et de la pêche maritime, le code forestier et autre code minier.
Ceci étant, l’énoncé dans ce rapport de la problématique à résoudre interpelle : comment améliorer la réparation du préjudice écologique au plan civil ?
II. Une approche technique de la norme environnementale qui traduit une vision utilitariste de la nature
En repartant du constat initial que le droit est le reflet des évolutions de la société[15], nous avons tous constaté en début d’année 2024 au travers du mouvement des agriculteurs la faible acceptabilité, voire l’hostilité à l’encontre de ce qui est décrit comme un empilement sans fin de normes environnementales dont il est devenu impossible de discerner un objectif global et cohérent.
Le sujet n’est pourtant pas nouveau puisqu’il était déjà abordé dans un rapport d’information sénatoriale du 29 juin 2016[16].
Le constat s’impose donc d’une contradiction entre d’une part une production pléthorique de normes environnementales disséminées dans des législations et autres codes épars, et d’autre part une efficacité d’ensemble très réduite, tant leur mise en œuvre semble insurmontable pour les acteurs concernés, voire pour les autorités chargées de les faire appliquer.
Le « reflet » de notre société qui en ressort semble révéler un paradoxe strictement impossible par lequel agriculture (et en creux, développement humain) et écologie ne seraient pas compatibles[17].
Un tel constat rappelle une série d’études publiées à la Semaine juridique édition générale en 2018 sur le thème « où va le droit ?», questionnement qui suggère selon Jacques Commaille que nous nous trouvons à nouveau dans un contexte historique exceptionnel[18].
Baptiste Morizot dans son ouvrage L’inexploré décrit des interrogations similaire sur notre rapport au vivant et propose de qualifier ce contexte historique par référence à la cosmogonie animiste : « le temps du mythe », un temps où sont remis en jeu les statuts et les relations entre toutes les entités[19], vivantes ou non.
Peut être y a-t-il lieu d’entendre ainsi notre « contexte historique exceptionnel ».
III. Une approche conceptuelle du droit éloignée des principe des sciences du vivant
Le droit est aussi une science.
Comme dans tout raisonnement scientifique, lorsqu’un raisonnement ou une construction mène à un paradoxe insoluble, une contradiction irréductible, voire une conclusion visiblement impossible, il faut réinterroger les postulats de départ, et en l’occurrence la vision de la nature qui guide le législateur dans cette production légistique tant décriée.
Notre vision traditionnellement utilitariste et fonctionnelle de la nature commence à être questionnée dans les laboratoires de recherche, et pas seulement ceux spécialisés dans les sciences dites dures[20].
Les juristes et les économistes notamment se questionnent par exemple sur la vision encore trop largement partagée dans leurs domaines respectifs d’une Nature qui serait seulement environnante et dès lors uniquement valorisée au profit de l’humain qui se situerait donc en dehors de celle-ci.
Ces questionnements qui semblent novateurs, voire disruptifs dans ces deux sciences sociales que sont le droit et l’économie ont pourtant été résolus de très longue date par toutes les disciplines relevant des sciences de l’environnement et du vivant, pour lesquelles la pérennité de l’espèce humaine réside dans la préservation des écosystèmes dont ils sont parties intégrantes et qui assurent leur survie.
Tous les quatre ans, l’institut du CNRS « écologie et environnement », l’un des dix instituts composant la direction scientifique de cet établissement de recherche, réunit sa communauté scientifique pour présenter les grandes avancées de ses recherches menées dans ses laboratoires et identifier les nouvelles disciplines et thématiques à soutenir dans les cinq années à venir.
Nous sommes loin, ici, des milieux militants.
Parmi les orientations à approfondir selon cet institut qui a contribué à l’émergence des fondements de la science de la durabilité adoptée par de multiples institutions et organismes de recherche à travers le monde, beaucoup visent clairement à enrichir l’étude des socio-écosystèmes, c’est-à-dire des écosystèmes compris en y incluant la présence et l’interaction des sociétés humaines dans l’objectif de décrire et restituer un niveau d’intégration supérieur et plus réaliste du monde vivant[21].
Ces travaux témoignent d’une orientation claire vers l’approfondissement des études des modèles non humains identifiés comme cohabitant avec les humains et susceptibles de se trouver en conflit d’usage des milieux ; nous sommes donc loin dans ces recherches de tenir ces modèles non humains comme simples éléments environnants qui pourraient subir sans conséquences les pressions du développement humain[22].
L’étude de la coviabilité humains/non humains (cohabitation et coévolution) y est clairement identifiée comme une orientation nécessaire[23].
La nécessité y est aussi identifiée d’engager des réflexions en droit autour de l’attribution de droits à des entités écologiques, dans l’objectif assumé par la communauté scientifique de contrebalancer une tradition d’appropriation et d’utilisation des non humains par les humains, au risque d’un déséquilibre d’ensemble susceptible d’enrayer les perspectives d’adaptation et de résilience à court, moyen et long terme[24].
En clair pour les scientifiques, les humains sont une composante parmi d’autres de la biodiversité, ce qui impacte nécessairement le sens que l’on prête à l’idée de protéger celle-ci, de même qu’est impactée la conception que l’on se fait de l’appropriation de la Nature, que celle-ci soit sociale, collective, ou individuelle.
Dans le domaine du droit, même les énoncés textuels les plus proches de cette réalité scientifique demeurent anthropocentrés.
Que ce soit le préambule de la charte de l’environnement ou l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans le meilleur des cas, l’ensemble des processus vivants qui assure la survie de notre espèce constitue un « patrimoine » certes commun, mais dont l’intitulé renvoie bien au concept de possession, de disposition au profit des êtres humains.
C’est ce concept de patrimoine commun de la Nation qui constitue le guide actuel d’élaboration d’un système de protection de l’environnement et de modalités de réparation du préjudice écologique, déjà reconnu comme insuffisamment efficace[25].
En France, la chercheuse Marie Angèle Hermitte, docteure en droit, défend depuis longtemps la Nature comme sujet de droit[26].
Bien que moins « médiatisé » que le débat ayant porté sur l’attribution de la personnalité juridique à des machines, le sujet à propos d’écosystèmes ou autres entités non humaines fait son chemin dans le monde entier.
A la différence des machines autonomes, l’objectif de cette proposition n’est plus de résoudre des problématiques de responsabilité mais uniquement de permettre d’accéder à un niveau de protection de l’environnement adapté aux besoins de la réalité telle que nous la décrit le monde des sciences dites dures.
Le concept de bien commun nécessite en effet une attention et une responsabilité qui pèsent entièrement sur les humains bénéficiaires des services écosystémiques identifiés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Nous serions ainsi censés partager une connaissance suffisante des besoins d’un écosystème et arbitrer sans erreurs et sans biais les conflits entre notre développement, le développement humain auquel nous participons et la préservation des équilibres de la nature.
Un tel arbitrage ne serait il pas en quelque sorte assaini par la personnification processuelle de la nature dont l’expression propre des besoins serait plus pleinement assurée ?
La pratique du droit commun de la responsabilité civile dont l’objet est de permettre la réparation d’un préjudice est par défaut fondée sur l’initiative procédurale de la victime et si celle-ci est incapable juridiquement, divers mécanismes de représentation existent qui rendent cette initiative procédurale effective.
Dans tous les cas, il est question de garantir à la victime de pouvoir porter elle même sa réclamation en justice ou devant d’autres instances et d’en maitriser pleinement le contenu pour elle même.
Pour le juriste contemporain, le droit processuel d’agir est d’abord attaché à la qualité de personne humaine.
Mais l’histoire nous enseigne d’une part que le droit d’agir, sinon d’être représenté, en justice ou devant d’autres instances, a déjà été reconnu à d’autres entités que les humains.
D’autre part, l’initiative procédurale de la victime comme la maitrise de la conduite de sa réclamation sont reconnues comme les moyens les plus efficaces de tendre vers le résultat recherché d’une réparation juste, voire de la prévention du dommage.
En définitive, la victime est tenue comme la mieux à même de revendiquer son préjudice et d’exposer sa revendication qui lui est propre à justice.
Dès lors qu’il est question de réparation, quel mécanisme, processuel ou autre, pourrait être aussi efficace que l’attribution d’éléments de la personnalité juridique à des entités dont la protection et/ou la restauration sont reconnues comme impératives à la survie de l’humanité ?
Au-delà de l’idée d’agir en réparation, reconnaitre à un écosystème le droit à une existence intangible, soit un autre attribut de la personnalité juridique, peut permettre de rétablir un équilibre d’intérêts entre les usagers humains des services écosystémiques offerts par la nature et visés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et les écosystèmes qui en assurent effectivement la pérennité.
A titre d’illustration, les arbitrages réalisés en urgence par les institutions décisionnelles de l’Union qui ont assoupli ou suspendu les dispositifs environnementaux les plus emblématiques issus de la nouvelle politique agricole commune (PAC) pour répondre aux protestations du monde agricole démontrent la grande fragilité de l’édifice d’ensemble si celui-ci est uniquement confié aux usagers humains des services écosystémiques, même avec les meilleurs intentions[27].
L’autre intérêt identifié par Marie Angèle Hermitte réside dans la capacité propre du droit à influer sur notre vision du monde au travers des concepts qu’il nomme et définit : les choses, les biens, les personnes sont autant de catégories juridiques qui façonnent et orientent notre compréhension du monde et nos interactions avec notre environnement.
Or en l’état du droit en effet, un écosystème demeure d’abord perçu comme un bien qu’une personne peut détenir en propriété, moins comme une entité dont les services écosystémiques sont utiles à tous et toutes.
Longtemps tenues pour farfelues, enfantines ou utopiques, les démarches de personnification juridique de la nature et de ses éléments se multiplient dans le monde, essentiellement dans un objectif processuel de protection et/ou d’intangibilité.
Les exemples abondent aujourd’hui, telles la loi néo zélandaise du 15 mars 2017 qui a reconnu la personnalité juridique de la rivière Whanganui, une loi espagnole qui a consacré la personnalité juridique à la lagune du Mar Menor, ou encore des décisions de cours suprêmes telle la Cour Constitutionnelle de Colombie qui a conféré la personnalité juridique au fleuve Atrato[28].
En France, la déclaration des droits du fleuve Tavignanu en Corse du 29 juillet 2021 attribue à ce fleuve des droits fondamentaux en tant que personne juridique.
Dans la même logique, la province des iles Loyauté en Nouvelle Calédonie avait désigné par une délibération du 29 juin 2023 relative au code de l’environnement de cette province les requins et les tortues comme entités naturelles sujets de droit.
Si le Conseil d’Etat a considéré que celle-ci touchant au droit civil relevait de la compétence de la Nouvelle Calédonie, la Haute juridiction n’a pas remis le principe de la démarche en question[29].
D’autres initiatives telles le Parlement de Loire[30] qui vise à faire reconnaitre à ce fleuve la qualité de sujet de droit dans le même objectif d’intangibilité et de représentation propre en justice en vue d’assurer une protection plus efficace font aussi des émules (Isère, Creuse).
La multiplication de ces démarches dont l’objectif concret est d’assurer un niveau de protection encore supérieur à celui permis par le concept de bien commun bousculent nécessairement notre vision du vivant et nous conduit à réinterroger aussi notre vision de nous même comme partie d’un tout.
Mais cette redéfinition de nos liens au vivant pourrait aussi peut être contribuer à résoudre beaucoup des apparentes contradictions auxquelles nous nous heurtons pour le moment et qui sont à la source des crises que nous connaissons.
Si ce mouvement de personnification de la nature se poursuit, il pourrait être à la fois la résultante et la source d’un changement de vision de l’être humain sur le monde et sur lui-même, avec pour corolaire un enrichissement du socle des valeurs civilisationnelles qui comprendrait la pleine reconnaissance de la Nature comme être à part entière participant à la conduite politique de nos sociétés.
Si elle s’inscrit dans cette orientation, l’introduction dans le code pénal d’un Livre dédié aux crimes et délits contre la Nature devrait traduire un renversement de notre conception du vivant et de notre place en son sein, très certainement vers un modèle plus proche de la réalité telle que nous la redécouvrons aujourd’hui au travers des études scientifiques les plus abouties.
[1] Sarah Vanuxem – La propriété de la Terre – édition Wildproject
[2] (2015/2103 (INL), mentionnant la nécessaire « création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers »
[3] G. Loiseau, La personnalité juridique des robots : une monstruosité juridique : JCP G 2018, act. 597
[4] Intelligence artificielle – Maîtriser les risques de l’intelligence artificielle : entre éthique, responsabilisation et responsabilité – Etude par Alexandra Bensamoun – La Semaine Juridique Edition Générale n° 05, 06 février 2023, doctr. 181
[5] Rémy Libchaber – Où va le droit ? – Là où la société le conduira… in La Semaine Juridique Edition Générale n° 28, 9 juillet 2018, doctr. 813
[6] Conférence de Glasgow de 2021 – https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
[7] https://www.cdc-biodiversite.fr/le-programme-nature-2050/
[8] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-protection-de-l-environnement-et-la-lutte-contre-les-pollutions/troisieme-conference-des-nations-unies-sur-l-ocean-unoc3-nice-9-13-juin-2025/
[9] https://www.wolterskluwer.com/fr-be/expert-insights/new-penal-code
[10] Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement
[11] Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020
[12] Philippe Billet – Un code, 20 bougies, un souffle in Énergie – Environnement – Infrastructures n° 1, Janvier 2021, alerte 1
[13] Une justice pour l’environnement – Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement – octobre 2019 – recommandation n°11
[14] Ibid page 7
[15] Eric Maurel in Cours de culture juridique et judiciaire – Enrick B éditions
[16] Normes agricoles : retrouver le chemin du bon sens – Rapport d’information n° 733 (2015-2016), déposé le 29 juin 2016
[17] Christian Mestre – La révision de la PAC : un renoncement à la hâte aux ambitions environnementales ? in Droit rural n° 8-9, Août-septembre 2024, étude 12
[18] Où va le droit ? – Repenser la légalité – Etude par Jacques Commaille in La Semaine Juridique Edition Générale n° 26, 25 juin 2018, doctr. 753
[19] « L’Inexploré », de Baptiste Morizot – édition Wildproject
[20] Par exemple https://recherche.pantheonsorbonne.fr/actualite/quand-nature-prend-ses-droits
[21] Prospectives CNRS écologie & environnement 2023 – https://www.inee.cnrs.fr/fr/prospectives-cnrs-ecologie-environnement-2023
[22] Ibid pages 30 et 80
[23] Ibid page 214
[24] Ibid page 83
[25] Cf supra mission d’évaluation des relations entre justice et environnement
[26] V. not. M.-A. Hermitte , La nature, sujet de droit ? : Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011, p. 173. – M.-A. Hermitte , Quel type de personnalité juridique pour les entités naturelles ?, in Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ?, J.-P. Marguénaud et C. Vial (dir.) : Mare & Martin, 2021, p. 83.
[27] Droit rural – La révision de la PAC : un renoncement à la hâte aux ambitions environnementales ? – Etude par Christian Mestre in Droit rural n° 8-9, Août-septembre 2024, étude 12
[28] Environnement et développement durable – L’eau à la croisée des communs et de la personne juridique – Etude par Marie-Alice Chardeaux in Énergie – Environnement – Infrastructures n° 5, Mai 2024, étude 18
[29] Environnement et développement durable – Protection des entités naturelles : les affres de l’incompétence – Focus par Philippe BILLET in Énergie – Environnement – Infrastructures n° 7, juillet 2024, alerte 103
[30]https://www.lefigaro.fr/nantes/une-declaration-des-droits-de-la-loire-en-preparation-de-la-touraine-a-l-atlantique-20240530