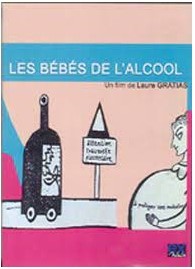L’alcool est puissamment toxique pour le fœtus, en particulier pour le cerveau et le système nerveux central.
Lorsque j’évoque ce sujet, mes interlocuteurs se disent très souvent bien informés ; mais lorsque je leur explique que l’héroïne par exemple, n’a pas cet effet toxique, en général les yeux s’écarquillent.
L’alcool est en réalité, et de très loin, la première cause non génétique de handicap mental dans le monde.
C’est aussi la seule qui soit totalement évitable puisqu’à la différence de la thalidomide ou de l’acide valproïque (deux autres molécules également toxiques pour le fœtus), sa présence dans des produits de consommation courante n’est jamais dissimulée.
Les effets d’une consommation importante sont bien connus et engendrent des malformations physiques identifiables qui s’ajoutent aux atteintes cérébrales et nerveuses.
Mais ces répercussions ne sont que la partie émergée de l’iceberg.
Les effets d’une consommation modérée, même ponctuelle sont moins connus, mais bien plus massifs dans la population générale.
Des niveaux de consommation faibles et parfaitement admis en société sont en réalité incompatibles avec la grossesse.
Ce point est essentiel parce qu’il permet de dissocier ce sujet de l’addiction à l’alcool.
La cour des comptes[1] et l’académie nationale de médecine[2] estiment que 8000 enfants naissent tous les ans porteurs de lésions cérébrales et nerveuses durables qui obèreront leurs chances de développement et d’intégration sociale.
La plupart ne sont jamais diagnostiqués, le plus souvent faute de connaissances suffisantes de la part des professionnels de santé et des services médico sociaux, et de mobilisation adéquate de ces professionnels dans des secteurs clés tels que l’éducation nationale et la justice notamment.
Mais alors que le nombre annuel de naissances touchées fait à peu près consensus, aucune autorité, aucune société savante ne s’interroge sur le devenir de ces enfants qui grandissent, deviennent des adolescents, puis des adultes.
8000 naissances par an sur une durée de vie moyenne basse donnent environ 500 000 personnes atteintes vivant dans notre pays.
La plupart n’étant pas diagnostiquées, comment évoluent elles alors que sans diagnostic, compenser les conséquences de leur handicap est bien plus incertain ? Quelles sont leurs chances de développer une vie sociale normale ?
En effet, les lésions neuro cérébrales durables engendrée par une exposition prénatale à l’alcool se traduisent à long terme par un retard mental, un déficit de l’attention, des difficultés à l’exécution de taches motrices fines, une altération des capacités d’apprentissage et de mémorisation, voire l’apparition de psychose.
Et ces lésions ne disparaissent pas avec le temps.
Au contraire, ces handicaps primaires exprimeront à leur tour des handicaps sociaux, tels l’incapacité de prévoir les conséquences de ses actes, une pensée abstraite déficiente, une incapacité à faire des choix, une absence d’aptitude organisationnelle, des troubles scolaires et des interactions sociales inappropriées compromettant leur insertion sociale et susceptibles de les placer en situation d’auteurs ou de victimes d’infractions pénales.
8000 enfants qui naissent chaque années entrent à l’école et lorsqu’ils arrivent en CP, se retrouvent plus ou moins rapidement en échec scolaire.
Adolescents, ils sont à risque de décrochage et jeunes adultes, de désinsertion.
Il faut donc regarder du côté des institutions chargées de lutter contre l’échec scolaire, l’exclusion sociale, mais aussi devant les juridictions pénales en particulier les comparutions immédiates et dans les prisons ou encore auprès des services de la protection de l’enfance.
Par exemple en France, 46 000 enfants âgés de 8 à 11 ans sont scolarisés en ULIS, ces dispositifs de scolarité adaptés aux enfants en difficulté.
Sur cette plage d’âge qui correspond à 4 années de naissances, 32 000 enfants (d’après la cour des comptes et l’académie nationale de médecine) sont nés porteurs de troubles causés par une exposition prénatale à l’alcool.
La proportion est immédiatement colossale.
Un raisonnement équivalent peut être tenu s’agissant des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance par les services du département, ou encore s’agissant des adultes en prison, dont les pouvoirs publics nous disent que 25% présentent des troubles mentaux.
Alors que tous ces services déplorent un manque de moyens et de places, si une partie importante de ces moyens et places est mobilisée pour la prise en charge de personnes atteintes de troubles causés par l’exposition prénatale à l’alcool alors que cette pathologie est identifiée comme évitable, qu’attendent ils pour se mobiliser ?
Sachant en outre que ces personnes ne sont pas diagnostiquées et que par répercussion, ces prises en charge ne sont pas adaptées, à quoi bon ?
Pourquoi le ministère de la santé, celui de l’éducation nationale, celui de la justice, les départements, se sentent si peu concernés par ce problème de santé publique qui impacte directement leurs ressources ?
Mon engagement sur ce sujet est d’abord une histoire familiale.
Mon père, Maurice Titran†, était pédiatre à Roubaix et directeur fondateur du Centre d’action médico sociale précoce (CAMSP) de cette ville.
Pendant des années, je l’ai vu se battre contre des moulins à vent pour tenter de faire reconnaitre la gravité de ces atteintes qui touchaient plus particulièrement des populations déjà fragilisées.
Pour ces familles, c’était la double peine.
Dans mes cours de droit de la consommation, on soulignait à quel point les producteurs étaient tenus d’informer les consommateurs sur les risques inhérents à l’utilisation de leurs produits.
Même une marque de margarine mentionnait sur ses emballages que son produit pouvait ne pas convenir aux femmes enceintes en raison de leurs besoins nutritionnels spécifiques.
Et sur les bouteilles d’alcool, rien.
Un moyens efficace de mobiliser l’état et les collectivités publiques, c’est de questionner en justice leur responsabilité.
J’ai eu l’occasion d’engager au début des années 2000[3] plusieurs procédures visant à rechercher la responsabilité de l’état à raison du non respect de la loi en matière d’étiquetage informationnel que l’état ne pensait pas devoir imposer aux alcooliers comme à n’importe quel autre producteur de produits destinés à la consommation courante.
Les obligations légales et réglementaires existaient pour tous les produits, et rien ne justifiait légalement que l’alcool en fût exempté.
Ces actions en responsabilité contre l’état m’ont d’abord donné la chance de rencontrer celle qui allait devenir mon épouse et la mère de mes enfants.
Laure Gratias† était journaliste indépendante, elle réalisait un film sur ce sujet de santé publique ; c’est ainsi que nos chemins se sont croisés.
Les actions en responsabilité engagées contre l’état et la formulation de la problématique de responsabilité juridique constituaient un élément éclairant pour le développement du film qu’elle préparait alors, et dont elle a tiré un livre.
Ces actions m’ont aussi permis de rencontrer d’autres femmes et hommes de bonne volonté et très vite, je me suis retrouvé à travailler avec une sénatrice, madame Anne Marie Payet, pour proposer des amendements et cibler les projets de lois qui pouvaient en constituer les véhicules, visant trois axes :
- L’étiquetage bien sur (puisque les alcooliers ne se sentaient pas concernés par les obligations légales que tous les autres producteurs respectaient)
- L’information de la population générale au travers de campagnes d’informations récurrentes
- La formation des professionnels de santé et des services médico sociaux, dont le déficit de connaissance était déjà stigmatisé
Ces amendements ont été adoptés, intégrant ces obligations dans le code de la santé publique et dans le code de l’éducation.
C’est à cette occasion que j’ai découvert l’activité de lobbyiste.
Cette activité n’est pas réservée aux acteurs économiques disposant de moyens importants : toutes les forces citoyennes peuvent s’en emparer.
Malheureusement et pour un prétexte très discutable, le Parlement abrogeait rapidement l’obligation légale de formation initiale et continue des professionnels.
A ces occasions, j’ai eu la chance de rencontrer des professionnels investis de tous horizons, dont le docteur Denis Lamblin, pédiatre à la Réunion et à l’époque directeur du centre d’action médico sociale précoce de Saint Pierre.
Denis Lamblin était venu se former à Roubaix, auprès de mon père et d’un autre médecin roubaisien qui avait activement contribué à faire émerger l’ampleur des effets de l’exposition prénatale à l’alcool, le docteur Philippe Dehaene†.
L’étude populationnelle conduite par Philippe Dehaene à Roubaix en 1991 [4] est encore aujourd’hui quasiment la seule étude de référence sur le sujet.
Dénoncée par plusieurs autorités scientifiques, la quasi absence d’étude en population générale depuis 30 ans témoigne là encore clairement de l’indifférence de nos sociétés à tant de souffrance et d’inégalités, que les pouvoirs publics ne cherchent pas à éviter.
Denis Lamblin avait monté une première association, RéuniSAF, destinée à faciliter la prise en charge de familles dont les ainés avaient pu être diagnostiqués.
Le travail en réseau qu’il avait élaboré autour de ces familles permettait d’éviter que les petits frères et sœurs de ces ainés soient également atteints.
La dimension innovante de son approche lui avait valu une distinction de l’Académie nationale de médecine
Ce pédiatre a également fondé une association destinée à la prévention primaire, Saffrance.
Faute de moyens et de soutiens publics, Saffrance a tenté de développer un partenariat direct avec les alcooliers sur une revendication commune claire, la nécessité d’une abstinence totale pendant la grossesse et ce dès que celle ci est en projet.
Saffrance a donc développé un partenariat avec l’association Prévention et Modération qui regroupe plusieurs fédérations de producteurs d’alcool et je l’ai assisté dans la rédaction des conventions de partenariat.
Un second partenariat a été mis en place avec l’UMIH, le puissant syndicat des métiers du milieu HCR.
Ces partenariats ont permis de mieux cerner l’état des connaissances sur le sujet dans l’opinion publique et chez les professionnels de santé.
Ils ont également facilité la mise en œuvre de campagnes de prévention primaire, notamment au travers d’un évènement annuel dénommé le Safthon.
Mais ils ont aussi eu pour effet d’éloigner d’autres acteurs de la communauté scientifique et des milieux de prévention, et même des acteurs publics de la santé qui voient dans ces partenariats des conflits d’intérêt insolubles.
Depuis quelques années malheureusement, le sujet piétine à nouveau dans un déni collectif parfois assourdissant.
Mais les enfants grandissent, deviennent des adultes qui veulent faire valoir leurs droits.
Hasard ou coïncidence, je viens d’engager pour l’un d’entre eux une nouvelle action en responsabilité contre l’état, actuellement en cours devant le tribunal administratif de Paris.
Il s’agit cette fois de dénoncer l’absence de diagnostic des populations atteintes à raison du déficit de connaissance des professionnels de santé notamment, et du défaut de prise en charge qui en résulte des personnes atteintes favorisant l’installation des handicaps secondaires si lourds de conséquences pour elles mêmes, pour leur entourage et pour la société.
Le combat continue sur ce sujet civilisationnel qui touche en définitive comme le sujet du climat, au rapport que l’humanité entretient avec son avenir et sa descendance au travers de ses choix de vie présents.
[1] https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160613-rapport-politique-lutte-consommations-nocives-alcool.pdf – page 22
[2] https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-alcoolisation-foetale-d%C3%A9finitif-14-3-16.pdf – page 10
[3] La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 30, 21 Juillet 2008, 2178
[4] Dehaene P, Samaille-Villette C, Boulanger-Fasquelle P, et al. Diagnostic et prévalence du syndrome d’alcoolisme foetal en maternité. Presse Med 1991 ; 20 : 1002.